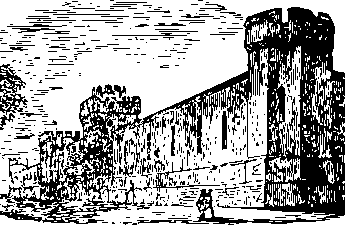Introduction : une crise européenne
En 1845, le mildiou frappe l’Europe.
Maladie due à un champignon parasitaire, le Phytophthora infestans fut vraisemblablement apporté (comme tant d’autres avant… et après lui) par des navires-cargos venant (non, pas de Chine, mais) d’Amérique du Nord, à l’été 1845. C’est d’Amérique également qu’arrivera plus tard en Europe le phylloxera, responsable lui aussi d’un véritable désastre (plus proche de nous, cette fois-ci, puisqu’il sera connu pour avoir ravagé les vignobles du continent… et notamment français).
Les conditions météorologiques de cet été-là (pluie et vent) contribuent à la propagation de la maladie ; si bien qu’à l’automne, entre 30 et 40 % de la récolte habituelle de pommes de terre sont perdus car, une fois parasité par le mildiou, le tubercule de la pomme de terre devient inconsommable : il se flétrit, noircit et pourrit, interdisant toute forme de récupération, même partielle, du féculent.
Entre 1844 et 1847, au fil de plusieurs années de maladie et de mauvaises récoltes, la production annuelle de pommes de terre en Irlande passe ainsi de 16 000 millions de tonnes à… 2 000.
La Grande Famine de la Pomme de terre a tellement marqué l’Histoire de l’Irlande que l’on oublie bien souvent qu’elle frappa en réalité toute l’Europe du Nord-Ouest : reste du Royaume-Uni (et notamment les Highlands d’Ecosse), Prusse, Belgique, France… En somme, toutes les régions où l’on cultivait abondamment la pomme de terre et où le mildiou décida de sévir. Néanmoins, si elle engendra souffrances et surmortalité dans toutes les régions concernées, il convient de reconnaître que ce fut, et de très loin, l’Irlande qui fut la plus touchée, avec une mortalité défiant toute concurrence.
Les chiffres
Pour prendre toute la mesure de la catastrophe humaine que fut la Grande Famine du point de vue tant de l’économie que de la démographie en Irlande, un bref coup d’œil aux chiffres suffit (si tant est que l’âme humaine puisse véritablement mesurer l’ampleur d’un tel drame) :
- En 1845, l’Irlande compte 8,5 millions d’habitants. C’est alors le pays d’Europe le plus densément peuplé (grâce à l’adoption de la culture massive de la pomme de terre) ; elle a un taux de natalité extrêmement élevé, et sa population rapportée à la surface des terres arables dépasse alors celle de la Chine (!)
- En 1852, au sortir de la crise, elle n’en compte plus que 5 : plus d’1 million d’Irlandais, hommes, femmes et enfants, sont morts de la famine (et de son cortège de fièvres, de carences et de maladies associées) et 1,5 à 2 millions se sont exilés, à la recherche de contrées plus clémentes.
Soit une perte brute de près de 40% de sa population. Et une véritable saignée qui ne cessera de se poursuivre tout au long des décennies suivantes. Car, si l’Irlande n’a certes pas attendu la grande famine pour entreprendre ses premiers mouvements d’émigration (vers les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, entre autres), la crise des années 1840 marquera un incontestable tournant dans l’émigration issue de la verte Éire : dès lors, et pour près d’un siècle, plus rien ne viendra endiguer le flot d’Irlandais fuyant la misère et partant tenter leur chance outre-mer : pendant plus d’un siècle, ce seront ainsi plusieurs dizaines de millions d’Irlandais qui partiront pour le Nouveau Monde (donnant naissance à une très vaste diaspora irlandaise).
Sans compter, sur le court terme, une baisse de la fertilité et, plus durablement, une forte baisse de la natalité (en Irlande, suite à la famine, les naissances ont baissé d’un tiers… ; elles reculeront aussi en Flandre, aux Pays-Bas et en Prusse, pour les mêmes raisons, quoique de façon moins dramatique).
Aujourd’hui encore, l’Irlande ne compte guère plus de 5 millions d’habitants. D’ailleurs, il aura fallu attendre 2021 pour qu’elle atteigne de nouveau ce chiffre (=celui de 1851) car, ayant continué à se dépeupler tout au long du XIXe siècle, elle n’avait plus jamais franchi la barre des 5 millions (ne parlons même pas des 8 du début du XIXe siècle !) depuis plus d’un siècle et demi ! Un fait si notoire qu’il sera mentionné dans la presse… Car, si presque partout ailleurs on s’est empressé de l’oublier, l’Irlande, elle ne l’oublie pas : la démographie, c’est un rude sujet pour l’île verte depuis 1850 ! Il aura fallu attendre plus d’un siècle de déclin pour que l’économie et, derrière, la démographie du pays se reprennent. (A titre d’exemple, en 1871, l’Irlande, qui a continué de se dépeupler, ne compte plus que 3,6 millions d’habitants ! Un chiffre repassé à 4,4 millions en 1911…)
A titre de comparaison, en-dehors de l’Irlande, le bilan de la crise est estimé à « seulement » 100 000 morts… toutes régions confondues… : 40 à 50 000 morts pour la Belgique (en Flandre, surtout), 42 000 pour la Prusse, 10 000 en France…
Ainsi, si tous les pays touchés par la famine verront leur taux de variation annuelle de la population diminuer (passant, par exemple, de +1% à +0,1% pour l’Allemagne, voire en frôlant le 0% d’augmentation), l’Irlande sera le seul pays à enregistrer une évolution négative de la population… avec un taux à -4% quatre années de suite !
En Ecosse, si la mortalité due à la famine s’avèrera beaucoup moins significative qu’en Irlande (et moins importante que pour les autres grandes famines écossaises, celles de 1690 et de 1780 en tête), les départs pour le Nouveau Monde en revanche, y seront massifs : on estime à environ 1,7 million le nombre d’Ecossais ayant quitté les Highlands à cette époque. Cependant, bien au-delà de la famine, d’autres raisons historiques et politiques auront encouragé ces départs : l’émigration de cette époque est couramment admise comme une continuation des des Highland Clearances avec des accents de nettoyage ethnique (voir mon article sur l’Histoire de l’Ecosse).
Pourquoi un tel désastre en Irlande ?
Les causes sont multiples, à la fois économiques, sociales et politiques. Et, pour certaines, très anciennes…
La pomme de terre au cœur de la vie quotidienne
En 1845, 32% des terres arables (soit 10% de la surface totale de l’île ! 800 00 hectares !) sont dédiées à la pomme de terre (contre 14% en Belgique, 11% aux pays-Bas, 11% en Prusse – les 3 autres pays principalement touchés par la famine – et moins de 5% dans les autres pays concernés : France, Suède, Danemark, Espagne…).
Comme dans les Highlands écossaises, pour la plupart des petits cultivateurs, la pomme de terre est le principal aliment quotidien : on en consomme en moyenne plus de 2kg par habitant et par jour, soit 2 à 4 fois plus que partout ailleurs (jusqu’à 5 ou 6 kg par jour pour un adulte actif). L’alimentation quotidienne dépend donc étroitement de la pomme de terre, et n’est que très occasionnellement enrichie d’un peu de diversité. Dans les faits, 4,5 millions d’Irlandais vivent sur la base de la pomme de terre (alimentation faite de pommes de terre exclusivement, trois fois par jour, pour 3 millions d’Irlandais, et de pommes de terre + produits laitiers pour 1,5 millions d’autres) = un total de plus de 50% de la population (8,5 millions d’âmes en Irlande en 1845).
Plusieurs raisons à cela :
- La pomme de terre est alors la seule culture capable de produire suffisamment de nourriture dans ce type de sol (humide, voire de mauvaise qualité dans les zones littorales exposées). A l’inverse de nombreuses autres cultures, la pomme de terre est donc idéale au regard des conditions irlandaises (climat humide, peu ensoleillé, sols acides, pauvres et tourbeux, semés de cailloux, pentes…) : elle s’accommode des terres ingrates et des vents violents et, si le blé ne peut guère s’y épanouir (surtout dans l’Ouest du pays), la pomme de terre s’y porte très bien et y donne d’excellents rendements (les bonnes années, 15 tonnes de patates à l’hectare !) ; elle se conserve également très bien et ne s’abîme qu’au bout de 9 mois, ce qui ne rend l’alimentation difficile que les 2-3 dernières semaines avant la récolte suivante… Hélas, cette même humidité sera particulièrement propice à la propagation du champignon en Irlande au moment de la crise…
- La pomme de terre est particulièrement nutritive ; à elle seule, elle permet à un enfant de grandir et de devenir un adulte en assez bonne santé (la seule déficience d’un régime à base de pommes de terre est celle en vitamine A.). Très facile à cultiver, peu exigeante, rentable, dotée d’un excellent apport nutritionnel, elle constitue donc un produit de subsistance idéal pour les couches les plus pauvres de la population paysanne : avec un petit lopin de terre, un modeste laboureur peut nourrir sa famille pendant plusieurs années. D’ailleurs, sans la pomme de terre, l’Irlande n’aurait jamais été aussi peuplée. Son accroissement démographique spectaculaire entre la fin du XVIIIe siècle et les premières décennies du XIXe (2,5 millions d’habitants en 1750, 8,5 millions un siècle plus tard, juste avant la crise, en 1845) est dû, précisément, à la culture de la pomme de terre. En résumé, les Irlandais vivent alors de la pomme de terre comme les Chinois du riz. On s’imagine sans peine ce qu’une mauvaise récolte pouvait, dans ces conditions, amener en termes de catastrophe…
- Les céréales cultivées et le bétail sont destinés à l’export (vers l’Angleterre) : ils servent aux paysans à payer leur loyer (métairies) et rien ne reste pour la consommation locale.
- En outre, en raison du pacte colonial liant l’Irlande à l’Angleterre, l’île, depuis plusieurs décennies, n’est en mesure ni de diversifier sa production, ni de véritablement s’industrialiser (voir ci-dessous).
Un terrain socio-économique fragile
Plusieurs autres facteurs économiques et sociaux contribueront à rendre la grande famine aussi meurtrière. En fait, la situation économique irlandaise elle-même, fort fragile, constituait un terreau idéal pour une crise d’une telle ampleur…
- En 1815, l’économie irlandaise ressort (paradoxalement) fragilisée de la chute de Napoléon. En effet, le blocus napoléonien imposé à l’Angleterre avait été bénéfique à l’Irlande, qui avait vu alors son rôle d’exportateur agricole renforcé : la Grande-Bretagne étant coupée commercialement du continent par la politique napoléonienne, l’Irlande se retrouver très sollicitée pour alimenter la Grande-Bretagne (exportations, défrichements…) Mais, avec la fin de la guerre et du blocus en 1815, et la réouverture de l’Europe comme grenier aux îles britanniques, la soudaine concurrence fait baisser les prix : les agriculteurs, mais aussi les quelques manufactures textiles irlandaises en pâtissent…
- D’autant qu’en 1824, le libre-échange total est instauré entre la Grande-Bretagne et l’Irlande : les industries anglaises, bien plus développées – et de loin : rappelons que l’Angleterre est la toute première à se lancer dans la Révolution industrielle – écrasent les entreprises irlandaises. Seule la région de Belfast, au nord (qui se reconvertit habilement dans la production du lin et investit dans la mécanisation) parvient à rester compétitive ; le reste de l’île est contraint de se replier sur des agricultures de subsistance (pomme de terre) ou d’aller chercher du travail ailleurs…
- La structure sociale en Irlande est, de surcroît, très inégalitaire. Au sommet, on trouve quelque 10 000 propriétaires fonciers, des Anglais et des Ecossais surtout, descendants des colons anglais et écossais des XVIe et XVIIe siècles (époque des « plantations en Irlande » : les campagnes militaires britanniques s’accompagnent alors d’une redistribution des terres aux nouveaux arrivants – voir mon article général sur l’Histoire de l’Irlande). Ces grands propriétaires louent à des tenanciers des parcelles ; s’ensuivent plusieurs niveaux de sous-locations sous la forme de petites parcelles. Si bien que les plus petits locataires n’ont que de minuscules lopins, sur lesquels ils font eux-mêmes parfois travailler des ouvriers agricoles, journaliers/brassiers, classe paysanne la plus pauvre (qui travaille en échange d’un salaire et non d’une part de la récolte). 2 à 3 millions de prolétaires agricoles se trouvent ainsi tout en bas de l’échelle, qui se déplacent pour vendre leur force de travail : ce sont eux, les plus fragiles, les miséreux qui seront le plus touchés par la famine.
- La menace d’une famine pèse déjà sur le pays : 16 disettes déjà ont frappé l’Irlande au cours de la première moitié du XIXe siècle.
- Enfin, facteur de fragilité supplémentaire : les paysans irlandais ne cultivent qu’une seule variété de pommes de terre (la lumper), rendant ainsi les plantations très vulnérables lors d’une épidémie…
Ainsi, si le champignon du mildiou sera l’étincelle qui mettra le feu aux poudres, la Grande Famine peut apparaître comme une catastrophe qui, dans un pays très peuplé à la pauvreté fortement enracinée, n’attendait qu’une occasion de se déclencher. Elle aurait pu néanmoins être considérablement atténuée dans ses effets les plus meurtriers si les autorités gouvernementales avaient bien voulu davantage s’impliquer…
De grands propriétaires intraitables et cupides
Pour des raisons historiques ( : les plantations en Irlande, entre autres… 👉voir mon article sur l’Histoire de l’Irlande), la majeure partie des terres en Irlande appartiennent alors à de grands propriétaires anglais (ou anglo-irlandais) à majorité protestante. Les paysans irlandais n’en sont que les locataires, redevables de loyers sous forme de céréales et de bétail (on l’a vu).
Or, pendant la Grande Famine, et alors même que le pays meurt littéralement de faim, les exportations vers l’Angleterre continuent. Les cultures de céréales (seigle, blé, avoine) sont elles-mêmes fortement impactées par la crise et nombre de paysans, placés dans l’impossibilité de payer leur loyer, se voient expulsés de leur maison et de la terre qu’ils travaillaient parfois depuis des décennies.
Pire encore : nombre de seigneurs et de grands propriétaire anglo-protestants y verront un moyen, d’une part, de se débarrasser des paysans catholiques (le conflit religieux, en Irlande, ne date pas d’hier…) et, d’autre part, de fusionner les différentes petites parcelles de leurs terres pour y créer de vastes pâturages (ce que certains cherchaient à faire depuis longtemps). L’expulsion des métayers sous prétexte de loyers impayés leur donnera l’occasion rêvée de revoir leur mode d’exploitation agricole…
L’incident dit de Ballinglass fut, à cet égard, relativement « exemplaire » : quoique aptes à payer leur loyer, les 300 habitants du village de Ballinglass, dans le comté de Galway, furent expulsés le 13 mars 1846 afin que le propriétaire britannique des terres puisse établir une ferme de pâturage à l’emplacement du village. Le premier soir, les habitants du village dormirent dans les ruines des maisons démolies par l’armée et la police ; dès le lendemain, les forces armées revinrent pour les expulser définitivement…
Résultat : des expulsions par dizaines, par centaines de milliers d’Irlandais, jetés sur les routes, souvent en plein hiver (500 000 expulsions estimées).
A contrario, et en comparaison, le nombre de cas recensés de propriétaires venus en aide à leurs paysans pendant la Grande Famine reste, hélas, terriblement faible (les Shannon, les Guinness… en font partie). La plupart des landlords, il est malheureux de le dire, vivent en Angleterre et réfléchissent aux politiques à mener en Irlande en fonction de leurs intérêts propres (notamment fonciers). Ce sera le cas, notamment, de plusieurs ministres. Maximiser leurs intérêts dans des conditions de ressources réduites (en expulsant les locataires pour consolider leurs revenus) accaparait, à l’évidence, bien plus d’énergie que de subvenir aux besoins d’une population sans force et affamée (et donc, désormais inutile…) Enfin, si certains grands propriétaires terriens (comme le comte Fitzwilliam ou le vicomte Palmerston) aideront matériellement leurs paysans à émigrer, ce sera le plus souvent c’est dans l’objectif de se débarrasser de locataires miséreux que par véritable humanité… Bien trop souvent, d’ailleurs, la frontière entre soutien financier et coercition (avec menace d’éviction) est faible.
La longueur de la crise
Si l’on pouvait à l’époque limiter les dégâts sociaux d’une récolte désastreuse – l’Irlande avait déjà connu des épisodes de famine au XVIIIe siècle, par exemple -, l’accumulation de deux, puis trois, puis quatre récoltes catastrophiques, voire décimées, rend les choses infiniment plus compliquées… Ainsi, si en 1845 la pénurie ne fut pas de plus grande ampleur que d’autres crises régionales précédentes (qui n’étaient pas restées dans les mémoires, et pour cause), ce fut l’anéantissement de la récolte de pomme de terre de trois des quatre années qui suivirent qui entraîna une famine et des épidémies d’une ampleur inégalée.
D’autant que le parasite n’est pas identifié comme tel immédiatement, empêchant toute solution efficace, et un endiguement de la crise. En effet, la première commission scientifique nommée par le gouvernement de Robert Peel (1841-1846) à l’automne 1845 désigne le climat humide et froid de l’été précédent comme responsable du pourrissement de la récolte et préconise d’abord la ventilation des tubercules puis leur immersion dans l’eau marécageuse…
Si le mildiou est finalement repéré, l’accumulation de récoltes ravagées et d’hivers rudes anéantit tout espoir de « sauver les meubles » ; d’autant plus que Londres ne fera pour ainsi dire « rien » pour endiguer éviter la catastrophe…
L’inflexibilité des autorités britanniques
Malgré l’ampleur de la famine qui s’annonce (du jour au lendemain, la classe des laboureurs n’a absolument plus rien à manger), et aussi incroyable que cela puisse paraître aujourd’hui, les autorités britanniques (le Premier ministre Robert Peel en tête) pratiquent la politique du laissez-faire, qui consiste en la non-intervention du pouvoir notamment dans le domaine économique.
En effet, l’Irlande faisant partie intégrante du Royaume-Uni depuis l’Acte d’Union (1800), l’organisation de l’aide publique en 1845 devait donc incomber au gouvernement britannique (basé à Londres, l’Irlande ayant perdu, par ce même Acte d’Union, son Parlement de Dublin, pour récupérer une centaine de sièges sur 600 à Westminster, une représentation tout à fait insuffisante, du reste, et parfaitement déséquilibrée au regard du poids démographique de l’Irlande au sein du Royaume-Uni…) Or, les années 1840 marquent en Grande-Bretagne le triomphe de l’idéologie libérale, celle du libre-échange et du laisser-faire en économie. Les dirigeants sont donc tout à fait hostiles à un trop grand interventionnisme étatique et sont pour laisser les « lois du marché » agir…
Il est donc hors de question, par exemple, de stopper les exportations, l’Etat ne devant certes pas se substituer au marché. Prônant le libéralisme à outrance, les Britanniques entendent bien laisser le marché se réguler par lui-même.
En outre, de nombreux politiciens se réfugient également derrière les théories providentialistes. Dieu a envoyé la famine pour punir les Irlandais (coupables d’innombrables péchés, c’est bien connu… ; le plus grave étant… de n’être ni Anglais, ni protestants pour la plupart…). Si Dieu a voulu cette famine, c’est donc pour des raisons qui lui sont propres, et ce serait une erreur (voire sacrilège) de vouloir intervenir… Après tout, ne s’agit-il pas là d’un châtiment mérité pour ces hérétiques, ces papistes, ces impies bien trop proches, par la foi et la liturgie, des Espagnols et des Français, ennemis traditionnels et héréditaires des Anglais ?
Enfin, les plus durs politiciens tombent dans la xénophobie (omniprésente à l’époque). La famine devient, très vite, une formidable occasion de renouvellement des discours racistes de l’époque ; on représente alors les Irlandais avec des faces simiesques, on les considère comme une race inférieure (aux Anglais, en tout cas !) dans la hiérarchie humaine, on se rappelle complaisamment qu’il s’agit d’un peuple de catholiques, de fainéants, d’alcooliques, d’arriérés, un peuple donc qu’il est bien inutile de vouloir aider : sitôt sorti de la misère, il ne mettrait pas dix ans à retomber dans les mêmes travers : on a là affaire à une société paysanne « arriérée », qui n’a pas su moderniser son agriculture, ni prendre le virage capitaliste du XVIIIe siècle. Une « arriération » découlant, aux yeux des dirigeants britanniques protestants, de l’obstination paysanne à persister dans le catholicisme, religion de superstition et d’ignorance qui s’oppose au triomphe des Lumières et à celui du progrès humain et social…
Faire preuve de charité serait donc un cadeau empoisonné pour ce peuple : autant donc laisser la nature (ou Dieu) faire son œuvre, ne pas s’en mêler, et espérer un assainissement de cette race par un fléau providentiel… Des journaux économistes libéraux et anti-irlandais se déchaînent (le Times en tête…) etc. Quant à Charles Trevelyan (le responsable britannique des opérations de secours… pas de chance !), il sera l’un des plus fervents partisans de cette théorie.
Sans oublier l’approche malthusienne, encore très en vogue à l’époque. Du point de vue des économistes, la crise est ainsi une conséquence du manque de rationalité des Irlandais. Ces derniers, en effet, se reproduisent trop, se condamnant eux-mêmes à diviser les parcelles familiales. La famine apparaît, dès lors, comme un moyen naturel de réguler cette croissance démographique « excessive » (population multipliée par 3,5 entre 1750 et 1845) et de ramener la population à un état d’équilibre par rapport aux ressources disponibles. Elle se présente également comme l’occasion idéale de réguler cette mauvaise organisation sous forme de couches superposées de locations successives et de se débarrasser de ce système de répartition des terres archaïque… Un comble, quand on pense que c’était une loi imposée par les Anglais eux-mêmes, la loi d’héritage de 1703 (figurant parmi les lois pénales destinées à discriminer les catholiques irlandais) qui instituait que les terres des catholiques, au lieu d’être transmises au fils aîné, devaient être divisées entre tous les fils d’une même famille, entraînant par là même un découpage permanent des héritages, une baisse importante de la taille des exploitations agricoles et, par conséquent, une vulnérabilité croissante de leurs exploitants… condamnant les Irlandais catholiques, pour subsister, à pratiquer principalement la culture de la… pomme de terre ! Tubercule, par excellence, ne nécessitant que peu d’espace pour être cultivé… Mais passons…
En somme, cette famine n’est-elle pas l’occasion inespérée et, n’ayons pas peur des mots, divine, de remettre enfin ce peuple en perdition dans droit chemin ?…
On ne s’étonnera guère, dès lors, que, de leur côté, les discours nationalistes et réactionnaires irlandais s’enflamment à la même époque !

Une inaction meurtrière…
En août 1845, Sir Robert Peel, Premier ministre britannique, est informé d’une maladie des pommes de terre dans le sud de l’Angleterre (premier signe que la maladie qui avait ravagé les cultures de pommes de terre en Amérique du Nord a traversé l’Atlantique). Cecil Woodham-Smith écrira qu’une pénurie en Angleterre serait grave, mais qu’en Irlande, ce serait une catastrophe. Peu après, en septembre, des cas de mildiou sont également signalés en Irlande (après plusieurs autres signalements en Angleterre). Le gouvernement britannique reste néanmoins optimiste encore quelques semaines, malgré les rapports alarmants qui, en octobre, commencent à arriver à Londres : il est bien connu que les Irlandais ont toujours tendance à exagérer…
Lorsqu’il est finalement invité à agir, à la toute fin octobre, Peel veut faire abroger les Corn Laws (Lois sur le blé) afin de libérer les importations de grain, mais n’y parvient pas. Il propose aussi qu’une commission de secours soit établie en Irlande, et qu’une somme d’argent soit avancée au Lord-Lieutenant (vice-roi d’Irlande, au service de la reine Victoria), mais les divergences apparaissent très vite dès lors que des fonds publics doivent être avancés.
En novembre, Peel ordonne finalement l’achat en secret de 100 000 livres de maïs et de farine en provenance d’Amérique pour les distribuer en Irlande (non gratuitement, bien sûr, mais pour pouvoir réguler le cours des céréales si celui-ci devait se mettre à flamber). L’objectif est donc de fournir le marché irlandais en céréales au printemps 1846 et de revendre le maïs à prix coûtant, sans faire de bénéfice sur le dos des affamés (mais sans leur fournir de nourriture gratuite pour autant, ni d’entraver l’économie libre de marché ou de pénaliser les entreprises…).
En outre, cet import semble bien modeste au regard des 3,5 millions de sterlings de pertes de l’agriculture irlandaise. Le même mois, les commissaires scientifiques confirment qu’entre un tiers et la moitié de la récolte de pommes de terre a été détruite en Irlande ; la famine est déclarée fin 1845, et les premiers morts tombent au début de 1846. Les germes qui avaient été mis de côté sont eux aussi touchés, le mildiou frappe de nouveau, et l’hiver est particulièrement rude.
En conséquence, en mars, Peel met en place un programme de chantiers publics en Irlande (travail contre nourriture, une politique fréquemment mise en place par les autorités britanniques – « un peu » dure, quand on pense aux rudes travaux proposés à une manœuvre affamée…) : sont embauchés ceux qui demandent de l’aide. Une politique récurrente en Grande-Bretagne (en cas de coup dur, on met les gens au travail dans le cadre de grands travaux, on leur fait construire des infrastructures… ce qui conduit, dans bien des cas, à une surmortalité, le paiement à la tâche étant particulièrement cruel dans un contexte de famine). De plus, ces travaux ne devant pas concurrencer l’économie productive, ils sont souvent secondaires, (voire inutiles ! en somme, c’est vraiment histoire de faire casser des cailloux…).
En revanche, le gouvernement rechigne à venir en aide aux centaines de milliers d’émigrés qui doivent quitter l’île par leurs propres moyens. Ainsi, le gouvernement agit, mais de la façon la plus désengagée et la plus légère possible. Hors de question de distribuer de la nourriture dans la rues ; les indigents doivent mériter l’aide gouvernementale en travaillant dur. L’idée n’est ni charitable, ni humanitaire : l’Etat veut simplement éviter à l’île de sombrer totalement dans la famine cet hiver-là.
Malgré tout, Peel, qui a sacrifié sa carrière sur le coup de la Corn Law, et dont les dépenses sont jugées malgré tout excessives, est contraint de démissionner de son poste de Premier ministre fin juin.
Le nouveau gouvernement whig de Lord Rusell, ultra-libéral, refuse totalement d’intervenir dans les affaires « économiques » de l’Irlande et met alors fin aux (maigres) mesures gouvernementales de secours alimentaire, laissant plusieurs centaines de milliers de personnes sans travail, sans argent et/ou sans nourriture.
Des initiatives privées se poursuivront (soupes populaires des quakers – voir section suivante –, import de céréales américaines, notamment de l’ « Indian Corn », le « maïs » amérindien, qui générera malheureusement divers problèmes, beaucoup d’Irlandais, ne sachant le préparer, tombant malades en le consommant ; en outre, le maïs étant pauvre en vitamine C, beaucoup d’Irlandais se mettent à souffrir du scorbut).
L’aide étatique, de son côté, reste réduite au strict minimum. Tout ce que le gouvernement propose finalement, c’est de rétablir les chantiers de secours… et de développer massivement les tristement célèbres workhouses. Ce sont alors ces asiles de pauvres qui prennent le relais et accueillent des milliers d’indigents dans des conditions déplorables de surpopulation, de séparation des familles, d’exploitation physique et d’insalubrité ; en mars 1847, l’asile de Fermoy (comté de Cork), prévu pour accueillir 800 pauvres, en héberge 1 800. Les bien portants et les malades sont logés ensemble si bien que, en l’espace de trois mois, 25 % des résidents meurent.
Mis en place en 1838 en Irlande par la Poor Law (loi sur les Pauvres…), les workhouses ne constituent pas un système nouveau (ils sont même assez anciens en Angleterre), mais c’est au cours du XIXe siècle qu’ils deviendront particulièrement (et tristement) célèbres, au point d’être retenus de nos jours comme emblématiques de la pauvreté à l’époque victorienne. Dans ces asiles pour pauvres, les indigents peuvent être secourus, mais dans des conditions extrêmement dures : familles séparées, repas chiches et frugaux, travail obligatoire 11 à 12 heures par jour, promiscuité, insalubrité… De fait, ces lieux pratiquent traditionnellement la moindre attraction : le but est d’attirer le moins possible les pauvres voire, dans l’absolu, d’éviter qu’ils ne se rabattent sur cette solution, et qu’ils cherchent à s’en sortir par eux-mêmes.
Ils sont ainsi sous-utilisés et le moins fréquentés possible jusqu’à la famine de 1845 ; mais, à partir de 46, ils sont débordés. La demande dépasse de très loin la capacité d’accueil et les workhouses se transforment en véritables mouroirs. L’hygiène est catastrophique, les épidémies se propagent à une vitesse vertigineuse. Sur le million de morts de la Grande Famine, environ 280 000 meurent dans les workhouses, en seulement 7 ans…
Début 1847, une nouvelle loi est votée au parlement britannique, la « Temporary Relief Act » (Loi de secours temporaire), plus connue comme la « Soup Kitchen Act » (Loi sur la soupe populaire), conçue pour apporter une nourriture bon marché directement et gratuitement aux masses démunies. Ces soupes populaires permettent de contrer les effets les plus néfastes de la dénutrition et de la sous-alimentation, mais le système, qui ne veut pas encourager l’oisiveté et la paresse pour autant, profite de ce que la récolte de 47 est un peu meilleure pour se démanteler fin septembre. Il a duré à peine 6 mois. Avec la récolte de 47, le gouvernement estime que la famine est finie.
En outre, la Poor Law de 1847 conditionnait l’aide alimentaire aux personnes possédant moins d’un dixième d’hectare, soit 1000 m2 de terrain, forçant ainsi les locataires des terres à céder leur bail pour pouvoir bénéficier de cette aide. On le voit, cette loi était loin d’être sans arrière-pensée, et devait permettre la concentration des terres au sein de grands domaines propices à l’élevage (pratique plus rentable et nécessitant moins de main-d’œuvre) et bénéficier aux grands propriétaires bien plus qu’aux indigents.
Hélas, de nombreuses familles, trop terrifiées à l’idée de perdre leur lopin de terre, renoncent à bénéficier de l’aide alimentaire et se laissent doucement mourir dans leur village, de peur qu’on ne leur confisque définitivement leur ferme. Les autres s’entassent dans les workhouses. La situation se détériore tellement que l’année 1847 est retenue comme l’année noire (Black Year) de la Famine. Les dispensaires de l’île sont saturés mais le gouvernement ne se décidera à les renforcer qu’en 51, quand tout est terminé.
En parallèle, et en conséquence des hivers et des famines 1845 et 1846, l’émigration massive a commencé et explose en 1847, avec 230 000 départs. D’ailleurs, dès 1848, les récoltes sont de nouveau détruites. La situation se dégrade, les gens meurent et fuient ce pays autrefois si fertile par centaines de milliers, mais l’Etat ne fait plus rien. John Russel reste le Premier ministre britannique de 46 à 52.
Pendant ce temps, le nationalisme, pourtant déstructuré par la crise, gronde. Au sein du mouvement Jeune Irlande, qui vient de voir le jour, une faction finit par être convaincue qu’il n’y a plus rien à attendre du gouvernement britannique, et qu’il est grand temps d’abroger l’Acte d’Union de 1800 intégrant l’Irlande au Royaume-Uni. Là, tout de suite. On se radicalise, on se dispute, les diverses factions nationalistes irlandaises traversent une douloureuse phase de scissions, de réconciliations et de désaccords. Le 29 juillet 1848, une première rébellion du mouvement Jeune Irlande, menée par William Smith O’Brien (presque malgré lui : il avait longtemps été conservateur et ne devient rebelle que contraint par la situation) tourne court ; les rebelles s’enfuient en Amérique ou sont condamnés à la déportation.
Les récoltes de 1845, 1846, 1848 et 1849 sont particulièrement catastrophiques.
Pourtant, le politicien britannique Charles Trevalyan décrète dès 1848 que la famine terminée et s’estime fort satisfait, au nom du gouvernement, de la gestion de la crise, qui aura permis une restructuration agricole… En somme, le mildiou a provoqué une destruction massive nécessaire pour l’avènement d’un ordre nouveau, selon lui.
La même année, jusqu’à 2500 personnes continuent de mourir chaque semaine au sein de workhouses.
1949 est la 4e et dernière année de crise : la pire. Les Anglais n’en peuvent plus d’entendre parler de l’Irlande, le racisme anti-irlandais et anticatholiques est à son apogée et l’opinion se désintéresse totalement de l’avenir du peuple voisin. Les Irlandais, de leur côté (et à juste titre), se sentent abandonnés. Le vice-roi fait venir la reine Victoria en Irlande pour réconcilier tout le monde, elle se monde gentille mais il est trop tard : toute réconciliation entre l’Irlande catholique et son suzerain protestant semble désormais impossible. L’Irlande a trop souffert, Londres a commis une grave erreur.
La récolte est meilleure en 1850, puis en 1851, et la famine est officiellement terminée en 1852.
Ainsi, les mesures prises par le gouvernement britannique sont-elles rares et parfaitement insuffisantes. Et, si le mildiou avait déclenché la crise, c’est l’inactivité du gouvernement britannique (ou au moins une activité inadéquate) qui mène véritablement à la catastrophe. Même l’armée britannique, qui possédait les plus grandes réserves alimentaires d’Europe, refusera de partager ses vivres avec les Irlandais.
Conséquence : en 1850, la classe des laboureurs des champs est pratiquement anéantie.
Un véritable scandale
Les nationalistes irlandais sont outrés : les initiatives privées, religieuses et étrangères donnent bien plus que le gouvernement britannique lui-même !
De fait, de grosses sommes sont levées
- par des particuliers (la reine Victoria donne personnellement 2000 livres sterling, le maximum dont elle puisse faire don à titre personnel ; cela eût pu sembler « généreux », si ça n’était pas accompagné, dans l’ombre, d’une conséquence proprement scandaleuse : car, lorsque le sultan ottoman Abdülmecit Ier déclare son intention de verser 10 000 £ pour les paysans irlandais, la reine Victoria lui demande de n’envoyer que 1 000 £, afin que son don ne surpasse pas celui de la souveraine du Royaume-Uni… Le sultan enverra donc 1 000 £ et trois navires remplis de nourriture… que les soldats britanniques tentèrent de bloquer !!)
- par l’Eglise (catholique) : le pape exhorte les archevêques à lever des fonds à travers l’Europe et l’Amérique. Ce mouvement de solidarité catholique se traduisit par un grand nombre de dons dont le montant total resta difficile à évaluer. En France, le journal catholique Le Correspondant lance une campagne de soutien aux plus démunis et la Société de Saint-Vincent-de-Paul envoie plus de 5 600 livres sterling aux associations caritatives irlandaises…
- par des collectes de fonds dans tout l’empire britannique
- par des associations caritatives (charités) privées, entre autres : les quakers qui, dès l’automne 1846 forment un comité central de secours à Dublin et dans les principales villes irlandaises. Grâce au soutien financier de leurs coreligionnaires nord-américains (et irlandais, pour certains de riches industriels), ces membres de la « Société religieuse des Amis » (un mouvement religieux fondé en Angleterre au XVIIe siècle par des dissidents de l’Église anglicane et marqué par l’absence de prêtrise et de hiérarchie religieuse, par l’égalitarisme et le concept de « lumière intérieure ») établissent des soup kitchens, des soupes populaires peu ou prou gratuites. Ils achètent également des semences, du matériel agricole, des cannes à pêche… Une générosité d’ampleur internationale en raison du phénomène de la diaspora irlandaise installée aux quatre coins du globe depuis le début du XIXe siècle. A New York, des comités de soutien sont créés et, en avril 1847, le voilier Jamestown part de Boston pour Cork chargé de provisions. Des dons arrivent du Canada, des Antilles et d’Europe, où des bals de charité et des ventes aux enchères sont organisés en 1846 et 1847.
- par des pays étrangers – les Etats-Unis en tête.
Comparativement, l’Eglise et les USA ont envoyé + d’argent que le gouvernement britannique !
Un… génocide ?
Comment, en effet, expliquer (ou plutôt : justifier, puisqu’on vient justement de l’expliquer…) que, pour reprendre les mots du grand homme politique britannique William Gladstone, « dans une période d’abondance, dans le pays le plus prospère de notre époque, un peuple meure de faim » ?
Comment comprendre que l’Empire le plus riche et le plus vaste du monde, l’Empire britannique de la reine Victoria, ait pu héberger en son sein, sans scrupule et toute bonne conscience, la « plus grande horreur des temps modernes » ? Qu’au sein du pays le plus avancé et le plus engagé dans la révolution industriel, doté du plus grand nombre de colonies, l’Etat le plus riche d’Europe et le plus riche du monde, une telle misère ait pu anéantir 12% d’une de ses provinces ? Comment accepter qu’aucune véritable politique d’émigration assistée, de soutien et de charité n’ait été mise en place ?
Plutôt difficile à défendre, on s’en rend compte sans peine. Alors que l’Angleterre continue de conquérir des territoires tous azimuts (voir ma Petite Histoire de l’Empire Britannique et mon article sur le règne de Victoria), un peuple meurt de faim au sein même du Royaume-Uni (puisque, rappelons-le, par l’Acte d’Union de 1800, l’Irlande a été annexée et intégrée au sein du « Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande »).
Alors que des enfants, des familles entières meurent de froid et de faim sur les routes, Londres continue de se faire engraisser à coups de cargaisons de grain en provenance des champs irlandais, et les convois de nourriture, escortés par l’armée, de sillonner le payer, vers les ports d’exportation. Les paysans ne peuvent toucher aux céréales qu’ils cultivent eux-mêmes, de peur de ne pouvoir payer leur loyer et d’être chassés de leur terre.
Et, alors que le gouvernement britannique, dix ans auparavant, dépensait 20 millions de livres pour aider les propriétaires d’esclaves à se remettre de la perte de leur main-d’oeuvre gratuite (abolition de l’esclavage dans les colonies britanniques), et dépensera 69 millions pour la Guerre de Crimée de 1853 à 56 (pour empêcher la Russie d’accéder au détroit de la Méditerranée…)… il n’aura pas levé plus de 7 à 10 millions de livres pour lutter contre la famine irlandaise !
Si bien qu’on ne s’étonnera guère de voir le célèbre activiste nationaliste John Mitchel (journaliste et historien) déclarer dans son ouvrage paru en 1860 La Dernière Conquête de l’Irlande (sans doute): « En effet, Dieu nous a apporté le mildiou mais ce sont bien les Anglais qui ont provoqué la famine ». Et, avec lui, toute une faction de nationalistes parler d’un véritable complot génocidaire destiné à tuer le plus d’Irlandais possibles ou, à tout le moins, de profiter de la crise du mildiou pour laisser la « nature » décimer (et donc considérablement affaiblir) une population jugée « rebelle », indisciplinée et indomptable. C’est Mitchel qui aura initié cette tradition historiographique dite « nationaliste » qui perdure aujourd’hui à la fois dans des ouvrages académiques et des histoires populaires de l’Irlande. En 2012 encore, le journaliste Tim Pat Coogan, dans son ouvrage Le Complot de la famine accusait ouvertement les Anglais d’avoir commis un « holocauste ».
A rebours de cette analyse, le courant historiographique dit « révisionniste » émergera en Irlande à partir des années 1930, diminuant considérablement la responsabilité des gouvernants et des administrateurs britanniques.
Si toutes les théories verront le jour, elles ne pourront être prouvées (notamment les plus extrêmes, envisageant rien de moins qu’un projet volontaire et d’une intention délibérée d’exterminer un pourcentage considérable de la population irlandaise – surtout papiste) ; néanmoins, nier la responsabilité des autorités britanniques est, avec le recul, devenu tout bonnement impossible. Il y eut bel et bien une décision et une volonté de « laisser faire » la nature et, tout au plus, des mesures tout à fait insuffisantes et parfaitement adaptées.
Ainsi, si la culpabilité/responsabilité du gouvernement britannique a longtemps été débattue par les historiens, et si l’ampleur de la catastrophe humaine a suscité dès le début – et jusqu’à aujourd’hui – nombre d’interrogations sur l’amplitude de la responsabilité des dirigeants britanniques (Combien d’Irlandais les gouvernants auraient-ils pu sauver ?), il est aujourd’hui communément admis que celui-ci peut être taxé, a minima, de « négligence coupable ». Car si la cause du désastre du désastre au sens strict n’est certes pas le gouvernement britannique, son ampleur est sans nul doute possible imputable aux choix politiques de Londres et à sa manière d’avoir choisi de gérer (ou de ne pas gérer) la crise : manque de protection des pops vulnérables, préjugés contre la pop irlandaises, idéologies verrouillées, dureté du système de workhouses, oppositions religieuses … sont bien plus responsables de la famine que le mildiou en soi ! Si elles l’avaient voulu, les autorités britanniques auraient pu sauver l’immense majorité des Irlandais !
Si bien qu’en 1997, soit un siècle et demi après le drame, le gouvernement britannique de Tony Blair offrira ses excuses officielles pour les préjudices subis par les Irlandais au moment de la Grande Famine… reconnaissant ouvertement que le gouvernement du Royaume-Uni de l’époque n’avait pas fait le nécessaire pour endiguer « une terrible tragédie humaine » qui, à l’occasion, s’ajoute à de nombreux autres facteurs pour raviver les tensions entre Irlande et Grande-Bretagne…
Un véritable drame humain
Plus d’un million d’Irlandais morts de faim…
… soit environ 12% de la population.
La famine tue de trois manières :
- Par la faim au sens strict, amaigrissement, anémie et dénutrition (10-15% des morts)
- Par les effets de la malnutrition (le fait de se rabattre sur de l’écorce, de l’herbe, des denrées avariées…) : diarrhées, œdèmes, dysenterie, scorbut… : environ 25% des morts
- Et par le cortège d’épidémies (choléra, typhus, fièvres, mais aussi tuberculose et scarlatine pour les enfants) qui se propagent aisément au sein d’une population très affaiblie et subitement surconcentrée dans les asiles pour pauvres (workhouses) et les grandes villes.
Les plus pauvres sont bien évidemment les plus touchés, mais les suivent souvent et rapidement dans la tombe les médecins, les administrateurs locaux, les prêtres et les pasteurs, bref, tous ceux qui portent secours aux plus affaiblis… et qui se retrouvent contaminés…
L’émigration vers l’Amérique… et le drame des coffin-ships
Les bateaux-cercueils
Entre 1,5 et 2 millions d’Irlandais quittent leur île natale. Seuls quelques 50 000 migrants bénéficieront d’une aide publique ou de l’assistance financière de l’Eglise, ou encore… de l’aide de propriétaires terriens : les landlords irlandais et les quelques hommes politiques favorables aux subventions à l’émigration ne parviennent pas à s’accorder sur l’éventuelle répartition des soutiens financiers et la plupart sont, de toute façon, partisans du laissez-faire et, sous leur influence, c’est la résistance étatique à tout projet de financement de l’émigration qui domine.
La majorité des migrants cherchent à partir pour les Etats-Unis, mais c’est également ce qui coûte le plus cher. Ceux qui ont la chance d’y avoir des proches, de l’aide, un soutien financier, ou qui ont le plus de moyens, s’y précipitent.
Ainsi, afin d’économiser une partie des frais sur la traversée de l’Atlantique, certains migrants irlandais font étape par les colonies canadiennes : le voyage vers le Canada (3-4 livres) étant d’un montant inférieur aux 5 livres minimum requises par les navires à destination des États-Unis, de nombreux Irlandais transitent donc par la colonie nord-américaine de l’Empire britannique avant, éventuellement, de franchir la frontière (encore assez poreuse) entre le futur Canada et les USA. En 1851, les Irlandais de première génération sont au nombre de 250 000 au Canada, installés majoritairement sur la façade atlantique, dans les provinces maritimes, Nova Scotia et dans l’Ontario. On trouve là ouvriers ou artisans qualifiés, domestiques, fermiers… Tous ceux qui ont pu se payer la traverser.
Les moins fortunés (ouvriers non qualifiés, manœuvres, Irlandais dépourvus de réseeaux familiaux, amicaux ou professionnels outre-Atlantique…) doivent se rabattre sur la Grande-Bretagne : Liverpool, Glasgow, Manchester, Londres, le Pays de Galles, l’Ecosse… accueillent ainsi de nombreux Irlandais qui, profitant du boom industriel en Grande-Bretagne (et notamment en Angleterre), s’engagent comme ouvriers dans les usines et sur les chantiers. Ainsi, un tiers des exilés d’Irlande se rabattent sur la Grande-Bretagne. On s’en doute : ces « réfugiés » fuyant la misère et venant prendre leurs emplois aux Britanniques sont bien mal accueillis ; d’autant que, dans la grande majorité des cas, il s’agit de catholiques… et qu’au-delà de la mer d’Irlande, on n’aime guère les papistes !
Ainsi, si l’idée est, bien souvent, de partir pour la Grande-Bretagne et de tenter d’y gagner assez d’argent pour ensuite pouvoir se payer la traversée vers les USA… dans les faits, beaucoup resteront finalement en Grande-Bretagne… ou se feront tout bonnement réexpédier chez eux, comme tous ces Irlandais refoulés de Liverpool (une ville alors déjà en pleine explosion démographique) s’ils avaient le malheur de perdre leur emploi ou de se présenter à un asile de pauvres (les fameux workhouses) ! En 1851, un quart de la population de la ville n’en sera pas moins irlandaise !
Concernant le Nouveau-Monde, et en particulier les Amériques, la migration de ressortissants irlandais ne date pas de la famine, certes, mais elle change considérablement de forme avec la crise des années 40.
En effet, entre la fin du XVIIIe s. et les premières décennies du XIXe, environ un million d’Irlandais quittent leur île natale pour tenter leur chance outre-Atlantique. Le migrant-type (un migrant « volontaire », autonome financièrement et indépendant) est alors plutôt jeune, souvent protestant, issu d’une famille de fermiers ou d’artisans – c’est-à-dire de la classe ouvrière qualifiée ou bien de la petite et moyenne paysannerie –, et son départ vers les Amériques se fait selon un processus de migration déjà solide (réseaux professionnels, familiaux, au sein d’une population déjà bien installée au Canada – alors encore colonie britannique, rappelons-le – et aux USA – qui ont acquis leur indépendance en 1776).
Le migrant de la Grande Famine, lui, n’a rien à voir avec ce fringant jeune homme partant, plein d’espoir, s’établir outre-mer et tenter sa chance au pays des self-made men et de l’American Dream. Il est affamé, seul ou en famille, jeune ou vieux, pauvre et expulsé de sa ferme, affamé, désespéré, pressé de fuir la misère. Il s’entasse pêle-mêle dans des navires-cargos (souvent sans médecins) qui ne tardent pas à acquérir le nom de « cercueils » en raison du taux de mortalité effarant qui y règne.
Souvent de marchandises, ces bateaux (bientôt dits « bateaux-cercueils »…) sont, bien souvent, le seul moyen de fuir accessible aux Irlandais démunis – et encore : ceux pouvant se payer la traversée, ou ayant de généreux cousins outre-Atlantique susceptibles de leur avancer les frais ou de leur payer le voyage ; en l’absence de toute aide étatique au départ, et de toute économie personnelle par ailleurs, les plus pauvres finissent tout simplement dans les fossés ou au sein des workhouses, car le prix pour les colonies canadiennes, pourtant relativement faible au regard de ce que coûte alors un aller pour les USA, représente le tiers du salaire annuel perçu par un manœuvre… et pendant les 5 à 9 semaines de traversée, aucun revenu n’est, bien sûr engrangé… Traverser l’Atlantique, il faut pouvoir se le permettre !
Si (malgré leur prix effarant, proportionnellement aux revenus des migrants) ces bateaux-cercueils constituent le moyen le moins cher de traverser l’Atlantique, c’est bien parce que les propriétaires, armateurs et capitaines de ces navires, souvent peu scrupuleux, parviennent souvent à contourner la Loi sur les bâtiments à passagers de 1803 et n’offrent qu’un accès aussi limité que possible, et par conséquent tout à fait insuffisant, à la nourriture, à l’eau et à l’hygiène à bord de leurs navires. Ainsi, si la loi définissait depuis plusieurs décennies le nombre maximum de passagers qu’un navire pouvait transporter ainsi que les quotas d’eau et de nourriture devant être fournis pour le voyage, la législation n’était, dans les faits, pas toujours applicable (et surtout pas toujours contrôlable), et nombreuses étaient les entorses à la règle.
En outre, cette législation ne s’appliquant pas aux navires partant de ports non britanniques… des milliers d’émigrants vécurent, dans les faits, des traversées infiniment douloureuses et, dans bien des cas, fatales. Accès aux ponts supérieurs et à l’air libre limités (voire interdits), enfermement dans les ponts inférieurs en cas de tempête…
Ainsi, bondés, insalubres et, bien souvent, inadaptés (de nombreux navires viennent du Canada chargés de marchandises – bois, maïs etc. – et ne sont absolument pas conçus pour accueillir des passagers, encore moins par centaines !), les bateaux-cercueils n’affichent que trop souvent des taux de mortalité de 30%, et rares sont ceux qui, comme le Jeanie Johnston, « le bon navire », et grâce de bons capitaines et de bonnes pratiques (doublés de chance…) n’enregistreront aucune perte de toute la Grande Famine. La légende veut que des requins auraient été vus en train de suivre les navires, tant de corps finissant jetés par-dessus bord.
Ainsi, avant même d’atteindre les côtes (et surtout, les îles de quarantaine…) américaines, ce sont des dizaines de milliers d’Irlandais qui meurent en pleine mer des épidémies qui circulent sur les navires. S’y ajoutent tous ceux qui, par milliers, meurent aussi pendant les périodes de quarantaine, parqués comme du bétail sur les îles, certes dédiées à cet usage, mais souffrant de capacités d’accueil totalement insuffisantes : Ellis Island (pour New York), Grosse-île (pour Québec et Montréal), Deer Island (pour Boston).
A titre d’exemple, si Grosse île était, de base, une île de quarantaine fonctionnelle, elle se retrouve complètement dépassée par les événements ; jusqu’à 12 000 personnes s’entassent à la fois sur cette île comportant un maximum de… 1000 places ! Ainsi, si le choléra ou le typhus se sont embarqués à bord d’un navire, ils continuent de frapper bien après que celui-ci ait quitté les eaux irlandaises… et bien avant que les survivants ne puissent fouler le sol américain ! Le seul été de 1847 (« l’année noire »), 5000 migrants irlandais (sans parler des médecins et du personnel d’accueil de l’île) seront enterrés sur Grosse Ile ; la même année, 700 enfants deviennent orphelins avant d’atteindre la ville de Québec.
On estime que ce sont ainsi pas moins de 50 000 migrants (10% d’entre eux) qui meurent avant d’avoir pu découvrir la fameuse « terre promise ». Les voyages les plus mortels sont accomplis en 1847, « année noire » (the Black Year) de la famine. Parmi les 100 000 migrants irlandais qui partent au Québec au cours de cette année-là, un sixième meurent soit à bord du navire soit dans l’hôpital de Grosse-Ile où ils étaient retenus en quarantaine.
Une composante importante de la population (et de l’Histoire !) américaine
Malgré cela, c’est un flot massif d’immigrants irlandais qui se déverse sur (notamment) l’Amérique du Nord. Si bien qu’en 1855, pas moins du tiers des habitants de New York viennent d’Irlande ! Se crée alors en Amérique du Nord un sous-prolétariat de gens malades et affamés (regroupé dans ces « petites Irlandes ») ; une main-d’œuvre peu chère, prête à tout, catholique bien souvent, sans ressources, qui s’installe dans des quartiers insalubres…. Ce qui ne manquera pas de provoquer, aux Etats-Unis comme en Angleterre d’ailleurs, des mouvements de répression, des protestations de la part des classes ouvrières locales et, bien sûr… l’émergence de syndicats, de sociétés secrètes de défense ouvrière contre les patrons… et d’une mafia demeurée célèbre ! Beaucoup d’Irlandais travailleront dans le bâtiment, le chemin de fer, les canaux, la police…
Et si bien qu’aujourd’hui également, ce sont pas moins de 40 millions d’Américains du Nord qui peuvent retracer des origines irlandaises… et retrouver dans leur arbre généalogique un homme, une femme, ou même un orphelin (adopté par une famille américaine ou canadienne…) débarqué de ces bateaux de la famine…
C’est le cas, tenez-vous bien, de près de la moitié des présidents américains (JFK et Ronald Reagan en tête, bien sûr), mais aussi de personnages aussi illustres que Henri Ford, Neil Armstrong, Jim Morrisson, Clint Eastwood, George Clooney, Mel Gibson, John Way Harrisson Ford, Robert de Niro, Johnny Depp…
Les coffin-ships n’en demeurent pas moins présents, tout comme la Grande Famine dans son ensemble, dans la culture populaire irlandaise…
Une tragédie qui demeure dans l’inconscient collectif
A terre, ce sont tout autant de tragédies qui demeurent dans les mémoires locales et collectives. L’incident de Ballinglass (l’expulsion forcée de ces 300 villageois pourtant encore en mesure de payer leur loyer à leur landlord et la destruction de leurs maisons en une journée), la tragédie de Doolough (voir le passage consacré à cette véritable honte dans mon roman !), l’histoire des bateaux-cercueils ne sont que quelques-unes des centaines de tragédies qui se jouent alors à l’échelle tant locale que nationale de 1845 à 1852.
La Grande Famine a marqué durablement l’inconscient collectif du pays et laissé une plaie vive dans l’âme des Irlandais. Elle demeure très présente dans la culture populaire (cinéma, musique…) et reste une cicatrice mal refermée dans la politique et les liens diplomatiques irlando-britanniques (malgré les excuses officielles de Tony Blair). Un sujet toujours débattu des historiens (notamment celui des responsabilités britanniques dans cette catastrophe) et régulièrement remis sur la table.
Conséquences
Outre les graves conséquences démographiques susmentionnées, (après la Grande Famine, l’émigration deviendra un phénomène structurel de l’Irlande, et un problème chronique : elle se poursuivit jusqu’en 1911, date à laquelle la population irlandaise tombe à 4,4 millions de personnes, soit son niveau… d’avant 1800 !), on peut recenser un certain nombre de conséquences de tous ordres de la Grande Famine de la Pomme de terre. Une crise qui aura impacté l’Histoire de l’île et façonné l’Irlande de la période contemporaine de plus d’une manière…
En matière d’économie agricole
On l’a vu : bon nombre de propriétaires terriens profitent du départ de leurs paysans pour procéder à la rationalisation et la modernisation de l’exploitation de leurs terres (un peu dans la logique des Highland Clearances en Ecosse…). Le phénomène de concentration des terres et d’augmentation de la taille moyenne des exploitations souhaité par les landlords (en une décennie, entre 1841 et 1851, la part des tenures de moins de cinq acres passe de 35 à 20 %, quand celle des tenures de quinze acres et plus augmente de 31 à 48 % des terres agricoles irlandaises) se fait pour le plus grand bénéfice des landlords : en 1870, 80 % des terres agricoles irlandaises leur appartiennent.
Il va sans dire que le paysage agricole irlandais s’en retrouve profondément modifié.
En politique
La montée du mouvement nationaliste
Malgré les fortes dissensions internes du mouvement (notamment entre radicaux-révolutionnaires et modérés favorables à la coopération avec Londres, entre autres) et l’impact de la Grande Famine sur l’énergie du mouvement (les Irlandais meurent de faim, la plupart n’ont guère plus d’autre priorité que de fuir ou de survivre), la crise aura bien évidemment contribué, en tant que véritable fracture avec les autorités britanniques, à renforcer davantage encore l’antagonisme entre nationalistes et Grande-Bretagne et d’exacerber la rancœur de la population envers Londres et Westminster. Cela aboutira, à terme (et en résonance avec d’autres facteurs, bien sûr) à l’indépendance Irlande quelques décennies plus tard (voir mes articles sur l’Histoire de l’Irlande).
Ainsi, bien que ses forces soient dispersées, la lutte pour l’indépendance de l’Irlande sort plus véhémente que jamais de la crise. Le pays n’a jamais été aussi meurtri, l’Angleterre ne s’est jamais montrée aussi sourde, dédaigneuse et cruelle à la fois (quoique… en si, en fait… mais c’était, sans doute, la fois de trop ; la liste des humiliations infligées par l’Angleterre à l’Irlande était déjà longue, ce maillon s’avèrera sans doute le maillon de trop dans la chaîne du martyre irlandais).
Une lutte soutenue depuis l’Amérique
A cause de la crise, et dans les années qui suivent, des milliers d’Irlandais sont arrachés à leur terre ancestrale. Leur arrivée en Amérique, et surtout aux Etats-Unis, leur ouvre des perspectives nouvelles, tant en termes économiques… qu’en terme de lutte pour l’Irlande… Car ils voient en leur pays d’accueil l’occasion, la chance unique, inespérée, d’une liberté totale, exempte de toute domination britannique ; et qu’ils sont prêts à lutter, même depuis l’autre côté de l’Atlantique, pour leur île et la cause irlandaise.
Ainsi, très vite, les émigrés envoient des fonds aux indépendantistes restés au pays, et fondent le mouvement Fenian, une organisation active dont le but consiste à mener des opérations violentes à l’encontre du gouvernement britannique, afin d’obtenir l’indépendance totale de l’Irlande.
Les émigrés irlandais influent également sur le gouvernement américain, afin de les inciter à réguler les agissements britanniques et à s’impliquer davantage. Et c’est à New York qu’est fondée l’IRB (Irish Republican Brotherhood) en 1858, organisation armée secrète qui organisera des attentats sur les sols britanniques et nord-américains dans les années 1860.
Certains émigrés retourneront même plus tard en Irlande, en 1867, afin de participer à la lutte pour l’indépendance menée par l’IRB et le mouvement Fenian.
Côté linguistique
En 1845, 90% de la population parle le gaélique ; en 1860… 20% seulement ! En une génération, l’île a changé complètement de langue. Et, en 1900, le pourcentage d’irlandophones du pays est tombé à 15% (la langue survit surtout dans la frange ouest du pays et quelques petites poches rurales).
Aujourd’hui, seulement 2% de la population de l’île parle le gaélique dans la vie courante.
Si elle n’est pas la seule cause de cette désaffection de l’irlandais, la Grande Famine en aura certes cruellement accéléré le processus.
Plusieurs raisons à cela :
- Au XIXe siècle encore, l’élite était très souvent d’origine et de nationalité britannique, et parlait l’anglais (langue de l’avenir, de l’économie, de la modernité…). L’irlandais était particulièrement parlé par les classes les plus pauvres… celles qui, bien entendu, seront les plus impactées par la famine… Donc, les classes les plus décimées… ou les plus frappées par l’exil.
- Les milliers d’orphelins issus de la Famine se retrouvent placés dans des orphelinats où seul l’anglais est toléré et enseigné… Une génération entière d’enfants oublie peu à peu l’irlandais, ou ne l’apprend jamais. (voir… mon roman !)
- Pour les émigrants, la langue fut majoritairement abandonnée avec le temps et les générations.
La vitalité de la langue irlandaise était, avant 1845, le principal signe de résistance du peuple irlandais à l’autorité britannique (une force vive que Londres ne parvenait pas, malgré tous ses efforts, à éradiquer). Affaiblie dès le début du XIXe siècle, elle ne se remettra jamais de la grande famine de 1845-1851, même elle redeviendra un levier important du nationalisme à la fin du siècle (qui cherchera à désangliciser le pays et à se réapproprier le gaélique, qui deviendra langue nationale en 1922 !!).
Conclusion
Après 7 années de calvaire, l’Irlande sort lentement de crise ; la famine est déclarée terminée en 1852, il s’agira de la plus grave famine européenne du siècle (une autre famine catastrophique frappera la Finlande en 1866) et de la famine la plus meurtrière proportionnellement à la population d’un pays (une personne sur huit en meurt, rappelons-le, pendant que 2 autres quittent l’île…) de toute l’Histoire contemporaine : en moins de 7 années, le pays s’est littéralement vidé d’un quart de sa population !
Une famine d’autant plus « remarquable » qu’elle ne survint pas dans un contexte militaire de guerre…
L’Irlande ne se remettra jamais de la Grande Famine du point de vue démographique ; si la surmortalité s’arrête vers 1852, les victimes de la famine continuent de mourir (notamment des épidémies) au-delà de cette date et, surtout, le mouvement migratoire restera intense jusqu’au début du XXe siècle : la population de l’île continue de décroître, il est de moins de 4 millions d’âmes à la fin du XIXe ! C’est un véritable trou démographique générationnel qui suit la Grande Famine, suivi d’un ruissellement pendant plus de 6 décennies…
Ce sera l’une des dernières grandes famines d’Europe ; mais elle laissera des séquelles pendant plusieurs décennies (pour ne pas dire jusqu’à nos jours) et bouleversera l’Irlande non seulement du point de vue politique, mais également culturel. Un phénomène qui aura impacté toutes les régions et toutes les classes sociales, même si le mal aura particulièrement frappé les populations du sud et de l’ouest de l’île.
Pendant longtemps, trop longtemps, les autorités britanniques refusent de reconnaître l’ampleur de la catastrophe et le rôle déplorable qu’elles auront joué dans son accroissement. Quant au travail de mémoire collective, il ne commencera pas avant des décennies : 2 millions d’Irlandais se sont exilés (et ne demandent qu’à oublier le drame), le choc est trop grand (on ne parvient pas même à prendre totalement conscience de ce qui s’est passé), Londres ne reconnaît pas officiellement la catastrophe, les paysans ont été dépossédés de leur terre, les populations déracinées, l’Irlande est traumatisée : c’est un véritable syndrome post-traumatique qui frappe la population irlandaise dans son ensemble et, si l’île aura beaucoup de mal à s’en remettre, il n’en faudra pas moins attendre le XXe siècle pour que le voile soit levé sur cette tragédie et qu’une mémoire collective puisse, peu à peu, se constituer.
En réalité, ce n’est qu’en 1995, à l’occasion de son 150e anniversaire, que la Grande Famine revient sur le devant de la scène, avec de nombreux travaux d’historiens qui rouvrent le débat de la responsabilité britannique. Depuis 2008, un jour de commémoration nationale a été institué en Irlande : le National Famine Commemoration Day, un dimanche en mai.
L’Irlande n’a jamais retrouvé la démographie d’avant la Famine.
A lire aussi sur ce blog :
- ma petite Histoire de l’Irlande en 3 parties
- les Gaëls, grands ancêtres des Irlandais
- mon roman L’Irlandais
Texte: (c) Aurélie Depraz
Illustration de l’article : source
—-
Excellentes vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=YI3qBalvpvc&ab_channel=KevinMoynihan
https://www.youtube.com/watch?v=-M9ZgME0UaM&ab_channel=LiguedeCorinthe
https://www.youtube.com/watch?v=dvLjRRZnpwg&ab_channel=Encore%2B
Sur le naufrage :
https://www.youtube.com/watch?v=r17Ub5ylZH8&ab_channel=Encore%2B
Petite histoire de la patate :