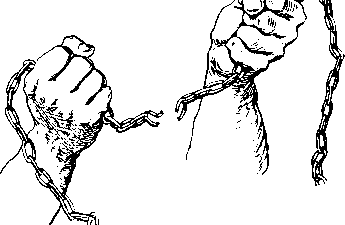👉🖋️ NB : Cette anecdote est issue de mon ouvrage Bordeaux et le vin, 2000 ans d’Odyssée. 📚
Aliénor et l’union anglo-gasconne
Il est bien peu de femmes dans l’histoire de France qui aient laissé une empreinte aussi importante que la belle et célèbre Aliénor d’Aquitaine. Tour à tour reine de France, puis d’Angleterre, femme de pouvoir et d’intrigue, l’ambitieuse Aliénor occupe en effet, aux côtés d’Héloïse, d’Anne de Bretagne, de Christine de Pisan, d’Iseut, de Jeanne d’Arc, de Marie de France, de Blanche de Castille et d’Agnès Sorel, une place de choix parmi les (rares) figures féminines de renom du Moyen Âge français.
Romanesque, tumultueuse et semée de péripéties toutes plus hautes en couleur les unes que les autres, sa vie, longue de plus de huit décennies (!) aura marqué non seulement le duché d’Aquitaine, mais aussi le duché de Normandie, le royaume de France et le royaume d’Angleterre, sans compter l’influence que ses nombreux choix politiques, mais également ses descendants (dont son fils, le très célèbre Richard Cœur de Lion) auront sur l’histoire de l’Europe tout entière. À la fois rayonnante et sulfureuse, passionnée et rebelle, séductrice et audacieuse, Aliénor s’est retrouvée au cœur d’innombrables intrigues, légendes, rumeurs et coups d’éclat de toutes sortes qui, près de neuf siècles plus tard, continuent de déchaîner la chronique, les biographes et les historiens.
Née autour de 1122, Aliénor devient, à treize ans, l’héritière de la très puissante Aquitaine et, à ce titre, sans doute le plus beau parti d’Europe. Le duché de son père (vassal du roi de France) couvre alors en effet un territoire absolument immense englobant à la fois la Gascogne, le Poitou, le Limousin et l’Auvergne (soit l’équivalent d’une vingtaine de nos départements actuels), une superficie bien plus vaste que les propriétés du roi de France lui-même (une poignée de provinces réunies autour de l’Île-de-France, de Soissons à Bourges), et son rayonnement économique et culturel surpasse de très loin celui du domaine royal.
Brillante, exaltée, Aliénor grandit dans une cour raffinée où l’amour courtois, né avec son grand-père Guillaume IX de Poitiers (un duc à la fois troubadour, guerrier et poète, aux mœurs excessivement libres, à la réputation sulfureuse et aux écrits licencieux), a droit de cité et où l’on aime les couleurs vives, le bon vin, la bonne chère, la musique, les plaisirs, faire la fête et les étoffes luxueuses.
À quinze ans, elle succède à son père, le duc Guillaume X, qui meurt sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Inquiet à l’idée de voir sa fille devenir l’objet de toutes sortes de convoitises s’il devait lui arriver malheur, et même devoir essuyer des rébellions en interne, Guillaume a pris soin, avant de partir en pèlerinage, de la placer sous la tutelle du roi de France, Louis VI le Gros qui, sitôt Guillaume disparu, ne résiste pas à la tentation et s’empresse de saisir cette occasion unique de rattacher plus solidement le duché d’Aquitaine au royaume de France en unissant Aliénor à son fils et héritier, Louis le Jeune. Certes, Aliénor resterait, en droit, propriétaire toute sa vie de sa dot fabuleuse – le duché – mais, à terme, celui-ci reviendrait aux descendants du couple, et finirait donc par fusionner avec le domaine royal…
Les deux fiancés se rencontrent au moment même du mariage, organisé par l’abbé Suger (de Saint-Denis) et célébré en la cathédrale Saint-André par l’archevêque de Bordeaux Geoffroy du Loroux, en juillet 1137. Mais tout se précipite, car à peine deux semaines plus tard les tourtereaux se retrouvent propulsés à la tête du royaume de France avec la mort subite de Louis VI, qui succombe à la dysenterie. Le jeune couple est sacré en décembre 1137 : Aliénor, duchesse d’Aquitaine, devient reine de France. Elle a quinze ans, Louis tout juste dix-sept. Il est le sixième roi de la dynastie capétienne.
Hélas ! Le jeune couple s’avère bien mal assorti, tant sur le plan physique que sur celui des tempéraments : à l’image de son duché à la fois bigarré, bouillonnant, chaleureux, emphatique, excessif et coloré, Aliénor est fougueuse, impétueuse, intelligente, rebelle, vive et parfois scandaleuse ; elle séduit, elle veut, elle tempête, elle aime badiner, elle est moderne et impulsive. Triste et fade, Louis à côté d’elle fait bien pâle figure, il n’est guère porté sur la chair (passionnée et charnelle, Aliénor se plaindra à moult reprises d’avoir épousé « un moine »), se sent écrasé, jaloux, amoindri, et s’enferme dans des positions butées. Les relations au sein du couple royal se dégradent très rapidement, renforcées en cela par la belle-mère d’Aliénor, Adélaïde de Savoie (qui ne manque pas une occasion de blâmer sa belle-fille pour ses manières et son langage un tantinet trop libres), mais aussi par la question de la venue d’un héritier, qui se fait longtemps attendre (Aliénor ne donnera naissance à une première fille qu’en 1145, soit huit ans après leur mariage, et à une seconde seulement six ans plus tard, en 1151).
En somme, tout sépare les jeunes époux et leurs suites respectives, les goûts, les caractères, les aspirations, et les tensions montent. Aliénor est déçue par Paris (une petite ville austère somme toute assez sale) et, surtout, contrariée dans sa soif de pouvoir (elle n’a pas voix au chapitre concernant les grandes décisions du royaume, qui continuent d’être influencées par l’abbé Suger, véritable ombre tutélaire du jeune roi). Plongée dans une austérité quasi monacale (Louis respecte tous les jours de pénitence imposés par l’Église, et ne fréquente donc qu’assez peu le lit de la reine – d’où, sans doute au moins en partie, de si rares grossesses…), elle est profondément déçue par son mari, qui ne s’avère certes pas à la hauteur de son tempérament flamboyant. Elle trompe donc son ennui et sa frustration par un mode de vie chatoyant qui apporte fraîcheur et modernité à la cour. Raffinée, éduquée, pétillante, Aliénor apporte une certaine joie de vivre avec elle et se réfugie dans la mode, la littérature, la culture, la poésie libertine et érotique des troubadours, la couleur des mots et des tissus, toutes sortes de dépenses, des achats au sein des grandes foires de Champagne… Ce qui ne fait que renforcer le cercle vicieux : on lui reproche ses toilettes trop voyantes, son maquillage, ses cheveux lâchés, ses troubadours, son badinage, sa suite bruyante et turbulente, ses frasques, ses intrigues, et jusqu’à sa beauté un peu trop tape-à-l’œil…
L’intermède tumultueux et peu fructueux de la IIe Croisade (1147-1149), à laquelle prend part le couple royal, ne viendra que confirmer la profonde mésentente régnant entre Louis et Aliénor. Le bilan global de l’expédition est un échec et, entre les deux époux, le torchon brûle plus que jamais. De fait, l’équipée n’a été qu’une longue série de dissensions, de mauvais choix et de sujets de querelles. N’y voyant que l’occasion de vivre de folles aventures, Aliénor, à la plus grande fureur des évêques, s’est entourée d’une troupe plus qu’hétéroclite (dames, suivantes, troubadours, chevaliers, jongleurs…) qui ralentit considérablement le convoi de croisés ; une fois sur place, la reine est séduite par les délices de l’Orient et, peut-être, dit la rumeur, par son jeune oncle Raymond de Poitiers, devenu Raymond d’Antioche, qui, à trente ans, porte beau et s’avère beaucoup plus séduisant que Louis VII… Une légende noire (mais sans doute mensongère et d’origine politique), qui collera longtemps à la peau de la reine, veut alors qu’elle ait eu une liaison avec lui… Quant à Louis, furieux et jaloux, il échoue lamentablement dans son siège de Damas. Finalement, le bilan de la croisade s’avère négatif, tant sur le plan personnel que militaire. Retour à Paris.
La situation ne s’améliore guère et, après quinze ans de mariage, le couple n’a toujours pas d’héritier mâle. On parle séparation, on cherche des prétextes. Finalement, et malgré les tentatives de réconciliation du pape Eugène III et de l’abbé Suger, le couple finit par invoquer l’argument de la consanguinité (l’Église ayant, depuis longtemps, interdit les mariages consanguins aux 4e et 5e degrés) pour obtenir l’annulation du mariage. C’est chose faite en mars 1152. Chacun s’en trouve satisfait, Aliénor retrouve son duché et sa liberté, elle est de nouveau maîtresse d’elle-même (et de nouveau le meilleur parti de France), tandis que Louis se trouve sans nul doute soulagé d’être débarrassé d’une épouse aussi encombrante, pour ne pas dire intenable.
Mais ce que le roi n’avait pas prévu, c’est le nouveau coup de théâtre que lui inflige son ex-femme deux mois à peine après leur divorce : le 18 mai 1152, à Poitiers, Aliénor se remarie… et sans même lui demander son consentement de suzerain, qui plus est ! Une nouvelle d’autant plus désagréable pour Louis qu’elle scelle l’union de la duchesse d’Aquitaine avec un autre de ses plus puissants vassaux : Henri Plantagenêt, duc de Normandie et comte d’Anjou, du Maine et de Touraine… À eux deux, Henri et Aliénor possèdent toute la moitié ouest de la France, des côtes de Normandie aux Pyrénées… Une union bien inquiétante pour le roi des Francs, qui se retrouve de nouveau cantonné à son minuscule domaine royal !
Mais, pour Louis, le pire est encore à venir. Car, non seulement, Aliénor aime follement Henri (de onze ans son cadet, il est fort, séduisant et pourvu d’une abondante crinière rousse) et noue avec lui une relation passionnelle au vu et au su de tous ; mais, en plus (pire scénario entre tous !), à peine deux ans plus tard, faisant valoir les droits de sa mère Mathilde (petite-fille de Guillaume le Conquérant), Henri hérite de la couronne d’Angleterre !
Reine de France encore deux ans plus tôt, Aliénor devient donc souveraine d’Angleterre… Une situation catastrophique pour le roi de France, qui voit deux de ses plus puissants féaux non seulement s’unir et créer une vaste et puissante principauté (comble du comble, toutes leurs possessions sont contiguës, leur permettant de contrôler tout l’ouest du pays), mais également se hisser sur un pied d’égalité avec lui, en montant sur le trône du principal royaume rival de la France !
Et, comme si cela ne suffisait pas à son humiliation, il semble qu’avec son jeune et fougueux mari, Aliénor prenne sa revanche sur quinze années de frustration. Henri incarne la puissance brute et la rude chevalerie, leurs tempéraments enflammés se renforcent mutuellement, la passion physique est au rendez-vous, et elle lui donne huit enfants en dix ans, trois filles et cinq fils (dont trois monteront sur le trône d’Angleterre…).
Aussi ambitieux l’un que l’autre, Henri et Aliénor se lancent alors dans la création d’un immense empire qui, bientôt, courra de l’Écosse aux Pyrénées et comprendra non seulement toutes leurs propriétés françaises, mais encore l’île d’Irlande à l’ouest, le Pays de Galles, la Bretagne…
Le couple est sacré en l’abbaye de Westminster (selon la tradition depuis le couronnement de Guillaume le Conquérant en décembre 1066 – la cérémonie se déroule toujours de la même façon depuis maintenant plus de neuf cents ans…) ; il s’installe à Londres, alors la plus grande ville du nord de l’Europe. Pendant qu’Henri II tente de pacifier le royaume (les conditions de la succession n’ont pas manqué de provoquer force remous), Aliénor recrée au sein du palais royal de Westminster la vie de cour qu’elle menait déjà sur le continent : elle fait venir d’Aquitaine non seulement ses plus fidèles troubadours, mais également des bateaux chargés d’épices, de soieries, de fruits exotiques et… de vins capiteux, bien sûr. Très vite, la cour d’Angleterre s’initie au raffinement à la gasconne et se convertit au clairet aquitain à la fois frais, léger, gouleyant et fruité. Dans la droite lignée de la maison de Normandie (celle de Guillaume le Conquérant), chez les Plantagenêts, on parle français à la cour et… l’on vit à la mode de chez soi.
Aliénor influence les arts de la table, chasse au faucon, fait la fête et, très complice avec son mari, gouverne avec lui, le remplace quand il est absent, règne à ses côtés. Le couple impressionne, on dit mari et femme interchangeables, Aliénor règne en son propre nom et Henri lui délègue ce dont il ne peut s’occuper. Elle élève leurs nombreux enfants pendant qu’il parcourt le royaume et impose son autorité, par les armes quand il le faut (excellent guerrier, Henri fera un formidable travail de pacification et d’unification de ses terres, avant, démesurément ambitieux, de se lancer à la conquête de nouveaux horizons). Sur l’idée d’Aliénor, son époux, en perpétuel mouvement, entreprend même de légitimer ses prétentions sur les îles Britanniques en tant que roi guerrier descendant d’un héros brittonique du VIe siècle, le roi Arthur, personnage mi-légendaire, mi-historique, qui aurait régné à la fin de l’Empire romain à la fois sur l’Angleterre et sur une partie de la France (Bretagne)… C’est ainsi avec Henri et Aliénor que l’incroyable légende du roi Arthur, d’Excalibur et des chevaliers de la Table ronde prendra son véritable essor…
Ce sont, pour eux, les plus belles années de leur vie.
Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. Et toutes les relations passionnelles, ce fameux moment où le vent tourne…
Bientôt, Aliénor perd de l’ascendant qu’elle semblait avoir sur son mari au début de leur union ; déjà bien trempé, le caractère d’Henri s’affirme davantage encore au fur et à mesure qu’il mûrit (rappelons qu’il est de onze ans le cadet d’Aliénor) et, de son côté, Aliénor refuse de voir digéré dans leur empire son cher duché, sur lequel elle entend bien garder toute autorité. Bientôt, une autre femme, jeune et belle, vient la remplacer dans le cœur du roi… Aliénor l’abandonne et vient s’installer en Poitou. Depuis l’Aquitaine, lentement mais sûrement, elle va nourrir sa vengeance et chercher à monter ses fils contre leur père, pour les hisser sur le trône anglais à sa place…
L’histoire d’Aliénor, d’Henri II, d’Henri le Jeune, de Richard Cœur de Lion et de Jean sans Terre, leurs fils, ne s’arrête pas là, bien entendu : elle amènera le couple royal à se déchirer, Aliénor à ourdir moult complots contre son mari, Henri à la retenir prisonnière pendant neuf longues années, Richard à partir en croisade et à être fait prisonnier par l’empereur germanique, sa mère (infatigable) à sillonner tout le royaume de France pour réunir la rançon destinée à libérer son fils préféré, le jeune frère de celui-ci (le prince Jean) à tenter de s’approprier le pouvoir en son absence…
Mais, pour ce qui est du tournant que prend alors l’histoire de Bordeaux et de son vignoble, l’essentiel a été dit : l’Aquitaine est entrée dans le giron du vaste royaume anglo-saxon… et elle le restera pendant exactement trois cents ans. Aliénor, à la fois grand-mère des Plantagenêts, des Tudors, des Stuarts et des Windsor, mais aussi de nombreuses autres grandes dynasties européennes, apporte avec elle à la cour d’Angleterre le plus précieux des présents aquitains, son vin et, avec l’ouverture du marché anglais, le vignoble bordelais connaît la plus extraordinaire période de prospérité de toute son histoire…
👉🖋️ Pour en savoir davantage sur l’Histoire de Bordeaux, découvrez mon ouvrage Bordeaux et le vin, 2000 ans d’Odyssée sur Amazon.📚
👉 Pour d’autres anecdotes bordelaises, c’est ici ! 🖋️
Texte : (c) Aurélie Depraz
Illustration article : image libre de droit – domaine public (source : Wikipédia)