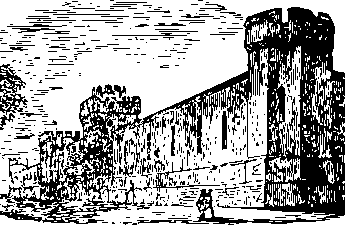👉🖋️ NB : Cette anecdote est issue de mon ouvrage Bordeaux et le vin, 2000 ans d’Odyssée. 📚
Attention ! Corsaire… pas pirate !
Quoique bien moindre célèbre en la matière que Dunkerque, Saint-Malo, Granville ou Saint-Jean-de-Luz, pour ne citer qu’eux, Bordeaux fut bel et bien concerné par l’activité corsaire à l’époque moderne…
Mais, avant d’évoquer davantage nos flibustiers bordelais, un petit rappel s’impose : tandis qu’un pirate, véritable bandit des mers, opère pour son propre compte, à n’importe quelle époque (et ce depuis l’Antiquité) et contre des marins de n’importe quelle nationalité, et voit ses méfaits passibles de la peine de mort s’il est capturé, l’activité de corsaire est typique de l’époque moderne et, à la fois officielle et réglementée, soumise à un ensemble de règles découlant d’une ordonnance royale sur la marine (en France, celle de Colbert).
Avant de partir en mer, un corsaire doit en effet obtenir une autorisation royale, « commission en guerre » ou « commission en guerre et marchandises » (et ce, pour chaque voyage). Ce document, appelé également lettre de marque ou lettre de course, n’autorise la lutte que contre les navires en guerre contre la France (anglais, hollandais, espagnols… selon les guerres et les circonstances) et uniquement pendant la durée de chaque conflit. Les prises ainsi opérées en mer font l’objet d’une déclaration à l’Amirauté et d’un contrôle rigoureux visant à s’assurer que le navire est bien de pavillon ennemi et peut ainsi être vendu, ainsi que son chargement, au profit de l’armateur du navire corsaire, de son capitaine et de l’équipage (moins les frais de déchargement, de vente, de justice et le dixième attribué à l’amiral et, à partir de 1713, la taxe de six deniers par livre au profit des Invalides de la Marine). Les passagers et les équipages des navires pris doivent être traités comme des prisonniers de guerre, de même que les corsaires de l’ennemi capturés, le cas échéant.
Guerre de la Ligue d’Augsbourg, guerre de succession d’Espagne, guerre de succession d’Autriche, guerre de Sept Ans, guerre d’Amérique, guerres de la Révolution et de l’Empire sont ainsi autant d’occasions, pour les corsaires français, d’affronter les navires ennemis en marge des guerres officielles et militaires, de maintenir les liaisons maritimes avec les colonies ou les comptoirs d’outremer et de soutenir massivement les batailles menées par les escadres de navires de ligne. De fait, la Marine royale, puis républicaine, puis impériale, fluctuant énormément dans le nombre et la quantité de ses navires et de ses équipages de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe, et sa force de frappe se trouvant régulièrement dominée par celle de la Navy, les corsaires sont d’une importance cruciale tout au long de l’époque moderne pour maintenir les liens commerciaux avec les colonies (et même le reste du monde). « Il faut donc se réduire à faire la course comme moyen le plus possible, le plus aisé, le moins cher, le moins hasardeux et le moins à la charge de l’État, d’autant même que les pertes ne retomberont que peu ou point sur le Roi » analyse Vauban en 1695.
À sa charge, à ses risques et périls, mais également à son profit, le corsaire arme donc un bâtiment en guerre et part rechercher, attaquer et saisir des vaisseaux ennemis, dont il espère de riches prises. Ces prises et produits sont alloués aux équipages, selon la législation en vigueur, et toute course, rigoureusement réglementée, n’est autorisée que pour une durée établie par le gouvernement. En temps de paix, en lieu et place d’une commission en guerre, le corsaire peut se voir attribuer une lettre de représailles l’autorisant également à courir sus à l’ennemi.
Évidemment, rien n’est jamais blanc ou noir, a fortiori en matière de piraterie… Bien souvent, un corsaire n’ayant pas donné entière satisfaction dans la Marine royale voit son contrat rompu et, de ce fait, se fera pirate. Inversement, lorsqu’un forban se fait remarquer par ses exploits, il est de fortes chances pour que l’Amirauté lui propose un contrat pour devenir corsaire au service de Sa Majesté. Enfin, quand se présentent des opportunités comme le transport de marchandises prohibées ou le commerce triangulaire, corsaire ou pas, l’appât du gain l’emporte bien souvent sur la moralité, et le corsaire pourvu de lettre royale n’hésite pas à se transformer, à l’occasion, en pirate guidé par ses intérêts propres…
Bordeaux, grand port de commerce, fut particulièrement concerné par l’activité corsaire. Au cours des quelque cent vingt années que dura cette forme de guerre maritime (tout particulièrement entre la France et l’Angleterre), et des quelque sept conflits majeurs qui la jalonnèrent (de la guerre de la Ligue d’Augsbourg à la fin des guerres napoléoniennes), ce sont quelque mille navires qui furent armés par les Bordelais pour la pratique de la guerre de course. Après avoir obtenu une autorisation royale confirmée par l’Amirauté de Guyenne (une pour chaque voyage) et versé une caution de 15 000 livres tournois garantie par un négociant reconnu (négociants, armateurs et corsaires sont souvent les mêmes), les corsaires engagent un équipage capable de servir l’artillerie, de se défendre, d’attaquer, de monter à l’abordage si nécessaire et de contrôler les navires capturés jusqu’à leur retour à Bordeaux, ou bien dans un autre port français (voire espagnol). Goélettes, bricks, corvettes, et frégates, soit tous les types de navires habituellement utilisés pour le trafic commercial, mais cette fois armés de canons, quittent alors le port, puis l’estuaire, et s’aventurent en pleine mer.
La majorité de ces navires sont construits par les nombreux chantiers navals de Bordeaux même. Les capitaines corsaires, quant à eux, sont des professionnels qui ont obligatoirement servi pendant plusieurs mois sur des navires de la Marine royale. En dehors de leurs qualités de marins, ils doivent commander des équipages difficiles à recruter et à maîtriser, donc s’avérer à la fois des meneurs d’hommes, des chefs de guerre, de bons tacticiens, de bons commerçants et d’excellents manœuvriers.
Quelques célèbres corsaires girondins et leurs navires :
- Guillaume Sebileau (1741)
- Jean Baritaut (1744) : L’Heureuse Paix
- Jean Blondel (1745) : La Marquise de Tourny
- François de la Girodais (1756, 1757, 1760) : Le Pour et le Contre ; La Fortune
- Jacques Kanon (1758, 1759, 1760, 1762) : La Valeur, Le Machault, L’intrépide
- Jacques Binaud (1758, 1759, 1761) : Le Faucon, La Marie, Le Hazard
- Jean Delzollier (1761) : Le Don de Dieu
- Jean Dignac (1775) : Le Galand
- Nicolas Despiet (1783) : La Brune
- Le Chevalier de Montazeaux (1778, 1779) : La Vengeance
- Jean Balguerie (1780) : L’Infant d’Amgale
- Jacques Perroud (1800, 1802, 104) : La Bellone
- Limousin (1809, 1810, 1812) : Le Phenix, Le Tanerlan, La Vénus
Au total, entre 1692 et 1815, soit en 120 ans, Bordeaux et l’estuaire de la Gironde seront le berceau d’un millier de corsaires, avec 4 capitaines corsaires pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1692-1694), 4 autres pendant la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714), puis 152 pendant la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748), 159 pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763), 506 pendant la guerre d’Amérique (1775-1783) et 214 pendant les guerres de la Révolution, du Consulat et de l’Empire (1793-1812). Autant de guerres[1] opposant systématiquement la France et l’Angleterre, mais aussi, selon les cas et les alliances du moment, les Provinces-Unies, la Saxe, la Prusse, l’Espagne, la Savoie, la Bavière, l’Autriche, le Danemark, la Suède, le Portugal, la Russie et les Treize Colonies d’Amérique. À mesure que la Marine française déclinera face à la Navy, les actes individuels, téméraires, parfois héroïques, parfois aussi particulièrement rentables, seront, on le voit, de plus en plus encouragés, jusqu’à la disparition de cette pratique.
Néanmoins, à l’inverse de Dunkerque ou de Saint-Malo, Bordeaux fut un grand port corsaire complètement méconnu. Daniel Binaud ne leur en a pas moins consacré tout un ouvrage, Les Corsaires de Bordeaux et de l’estuaire, publié chez Atlantica en 1999, dans la lignée de l’œuvre de Henry Ribadieu, Aventures des Corsaires et des grands Navigateurs bordelais (1854) et de l’ouvrage collectif La Marine Bordelaise : Corsaires, pirates, négriers, Les Dossiers d’Aquitaine, Collection Mémoires & Patrimoine.
[1] On parle parfois de « seconde guerre de Cent Ans » pour qualifier cette période de guerres quasiment incessantes entre la France et l’Angleterre, du règne de Louis XIV à la chute de Napoléon (1689-1815). Un affrontement qui se concentre dans les eaux européennes au XVIIe siècle, pour se déployer progressivement sur les mers du monde en raison des enjeux coloniaux croissants et impliquant des zones géographiques de plus en plus éloignées. C’est l’époque des grands combats navals entre vaisseaux de marines ennemies, autant de duels épiques immortalisés par l’art pictural et incarnant la défense farouche des honneurs nationaux.
👉🖋️ Pour en savoir davantage sur l’Histoire de Bordeaux, découvrez mon ouvrage Bordeaux et le vin, 2000 ans d’Odyssée sur Amazon.📚
👉 Pour d’autres anecdotes bordelaises, c’est ici ! 🖋️
Texte : (c) Aurélie Depraz
Illustration article : image libre de droit Pixabay