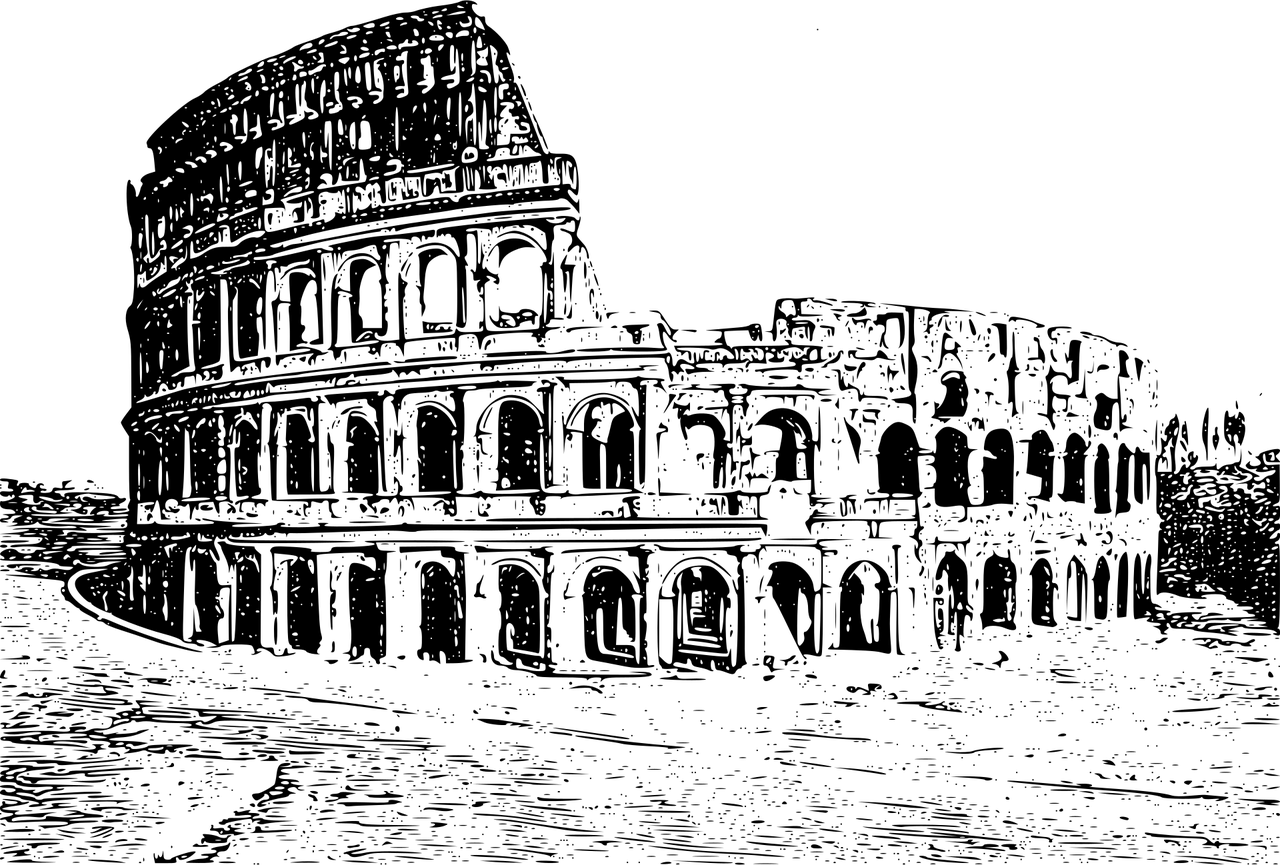👉🖋️ NB : Cette anecdote est issue de mon ouvrage Bordeaux et le vin, 2000 ans d’Odyssée. 📚
Le Palais Gallien, vestige méconnu de l’époque gallo-romaine bordelaise
Un peu à l’écart du centre-ville et de tous les autres points d’intérêt historiques de Bordeaux, les ruines du Palais Gallien, peu signalées, passent souvent inaperçues des touristes de passage. C’est bien dommage, car de voir les ruines d’un ancien amphitéâtre romain de Burdigala intégrées à même un quartier résidentiel, et pour ainsi dire accolé aux murs des échoppes environnantes, c’est quand même quelque chose !
Visibles entre la rue du Docteur-Albert-Barrau et la rue Fondaudège (et en accès libre!), ces ruines (du nom de l’empereur Gallien, qui l’aurait fait construire) permettent d’établir que l’arène intérieure du colisée bordelais mesurait 70 m sur 47, pour un pourtour de 132 m sur 111 et une hauteur de 25 m. Doté d’une belle technique de construction alternant lits de briques et petits moellons de pierres blanches (donc en opus mixtum, appareil employé à la fin du IIe et au IIIe siècle), le Palais Gallien pouvait accueillir entre 15 000 et 22 000 spectateurs, ce qui en fait l’une des plus grandes arènes de Gaule. Le rythme architectural de l’ensemble (structure en 7 ellipses concentriques nervurées en 64 travées donnant sur autant d’arcades extérieures ; et deux portes, une à chacune des extrémités de l’ellipse) aurait répondu au besoin d’assurer à chacun l’accès à sa place et de permettre, après le spectacle, une évacuation rapide.
On présume que l’amphithéâtre aurait été incendié lors des grands raids des Francs sur la Gaule (en 275-276), et la tradition précise même qu’il aurait brûlé pendant deux jours (ce qui semble corroborer l’existence de gradins en bois) ; néanmoins, ce fait est débattu.
Par la suite, le Palais Gallien sombrera dans l’oubli. Comme de nombreux autres édifices avant que le concept de « monument historique » (ou même l’ébauche d’une conscience patrimoniale) ne voie le jour (au XVIIIe siècle seulement, et plus massivement au XIXe…), il servira, selon les époques et leurs besoins, tantôt de dépotoir et de décharge publique (notamment des tanneurs et autres artisans du voisinage – autant d’ossements, de carcasses, d’amas de chaux et de déchets formant une couche très nettement identifiable pour les archéologues), tantôt de quartier sulfureux servant de refuge aux truands, prostituées, adeptes de sorcellerie et autres marginaux, tantôt encore de zone propice aux duels ou de carrière d’extraction publique (sable, moellons, briques, graves). On dit même qu’au XIe siècle, de la vigne y poussait !
Finalement, son terrain est vendu par lots à la Révolution, et plusieurs parties d’ouvrage monumentales (comme la porte est) sont abattues pour ouvrir des rues et permettre un accès aux nouveaux propriétaires du lotissement. La ville, endettée, vend le Palais Gallien (ainsi que d’autres monuments d’importance, comme le Palais de l’Ombrière) au titre des biens nationaux. Seuls la porte nord-ouest et quelques arcs sont sauvés par des commissions qui se démènent pour préserver quelques ruines.
Il faudra attendre 1800 pour que la collectivité publique prenne des mesures afin d’endiguer la dégradation de l’édifice et d’interdire toute nouvelle mutilation. Des décrets, enfin, figent les démolitions… mais le mal est fait. Le site est classé monument historique en 1840, toutefois la majeure partie de l’assiette d’origine du Palais Gallien est déjà recouverte de maisons.
Et l’urbanisation se poursuit : si le titre de monument historique interdit de s’attaquer aux dernières ruines (celles que l’on peut encore voir aujourd’hui), les propriétaires en place ne se privent pas d’y adosser d’autres édifices, comme des garages. Finalement, la mairie se décide à racheter les maisons attenantes aux ruines pour les faire démolir. Les ruines sont restaurées, des prospections archéologiques menées là où on le peut encore.
De nos jours, seules quelques arcades et travées, enserrées dans le tissu urbain, sont encore visibles. Elles ne représentent qu’un sixième de l’édifice d’origine, mais n’en donnent pas moins un brillant aperçu de l’ellipse considérable que devait occuper l’amphithéâtre à son âge d’or, une arène qui n’avait rien à envier, ni par la taille ni par le prestige, à celles d’Arles et de Nîmes…
👉🖋️ Pour en savoir davantage sur l’Antiquité gallo-romaine à Bordeaux, découvrez mon ouvrage Bordeaux et le vin, 2000 ans d’Odyssée sur Amazon.📚
👉 Pour d’autres anecdotes bordelaises, c’est ici ! 🖋️
Texte : (c) Aurélie Depraz
Illustration article : image libre de droit Pixabay